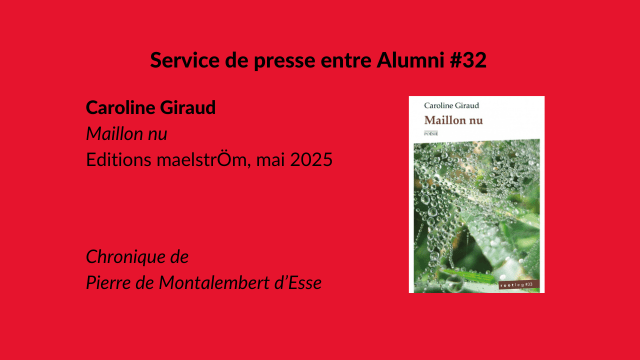Services de presse entre Alumni #32 : Maillon nu, de Caroline Giraud
De la perte (« se mettre dans les yeux d’un autre, à la place d’un autre ») jusqu’au « retour au monde, dans sa plénitude » en passant par la violence : Pierre de Montalembert d'Esse (promo 2006) nous emmène avec lui en voyage dans Maillon nu de Caroline Giraud (promo 2001), paru en mai 2025 aux éditions maelstrÖm.
Le livre
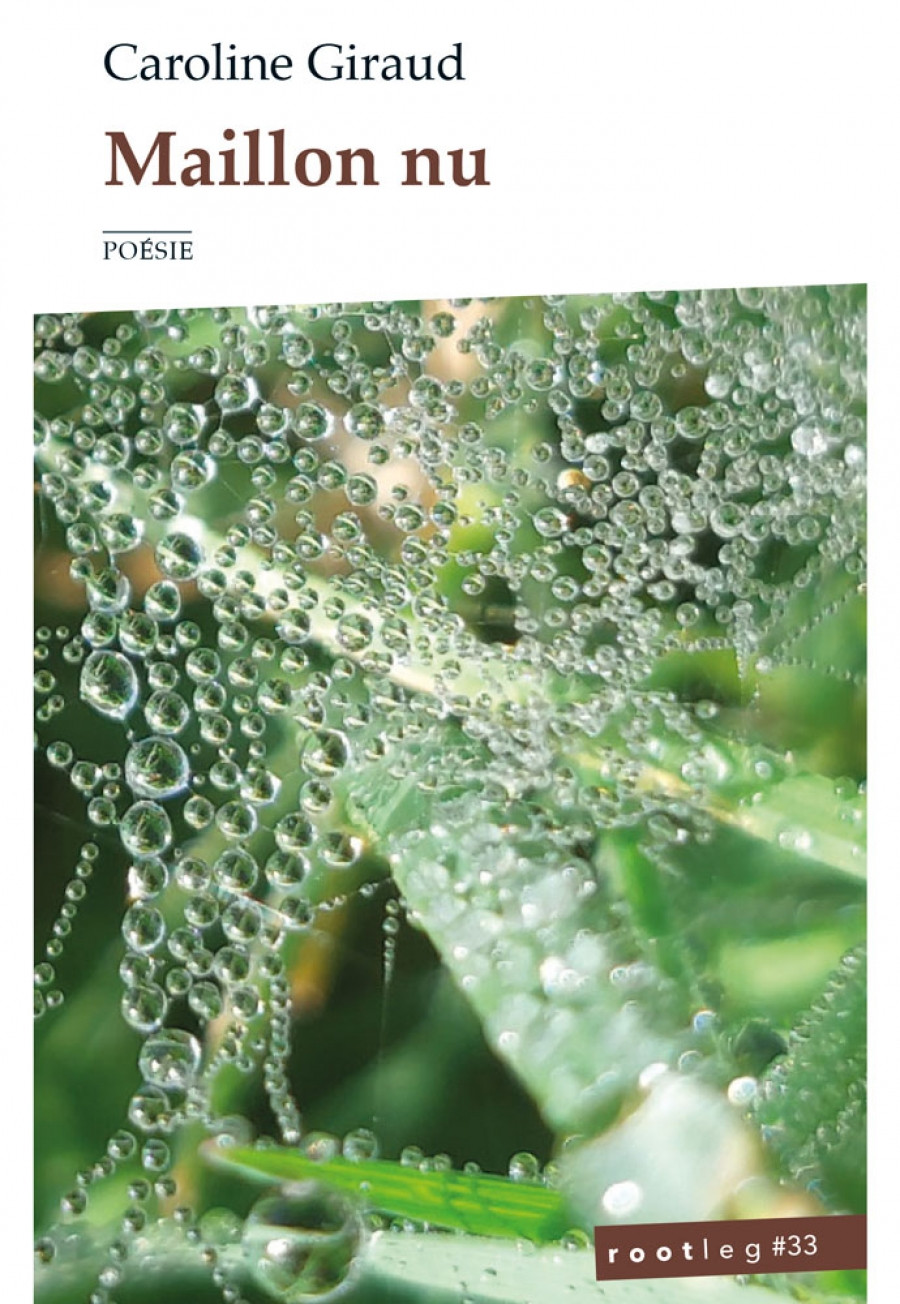
L'autrice
Caroline Giraud (Caro Giraud) propose un univers poétique sensuel où le rapport à la nature tient une place essentielle et cultive un éclectisme de ton et de forme dans l’écriture.
Investie dans des collectifs et projets de recherche autour des nouvelles pratiques de poésie digitale, elle publie en revue depuis 2022 (Terre à ciel, Zone Critique, la forge, margelles, pro/p(r)ose, Lichen, hélas! Cahiers rouges, Les Haleurs, Peau électrique, Prose combat...).
Elle est l'autrice de Moelle immense, un livre-objet illustré et conçu par l’artiste ukrainienne Yuliia Ignat, de Maillon nu aux éditions maelstrÖm (mai 2025) et de Nous liquides aux éditions de L'Entrevers (septembre 2025), chroniqué pour le club Littérature par Frédérique Trimouille.
Présentation du recueil par la maison d'édition
« Tu n’as pas attenduComment saisir une réalité qui nous glisse entre les doigts, un monde connu qui se désagrège ? Comment survivre à la dissonance ? Par le rebond poétique.
Maillon Nu tisse une chaîne d’espoir et de sens où la lumière finit toujours par surgir.
Postface Olivier Liron
Un poème choisi par Pierre
Je partirai un jour de mai
entre le soir et les mirages
je partirai avant l’orage
entre la terre et les nuages
je partirai avant l’été
dans un vent frais
léger
...........léger
je partirai pour qu’au matin
on me parcoure
comme un jardin bleuté
tranquille enfin
L'avis de Pierre
Les yeux d’un autre (crépusculaire)
C’est par ce titre que débute le recueil, et cette expression s’éclaire dès le premier poème :
« Je voudrais une fois
écrire avec les yeux d’un autre
qui ne douterait pas […] »
D’emblée le poème dit la fragilité, la crainte, le désir de ne plus être assailli(e) par les tourments et les « remords ». Mais la dernière ligne laisse planer le doute : « ce serait reposant ». Certes, mais ne faut-il pas voir là comme un sarcasme ? Ces premiers vers ont suffi à tracer une direction, qui va à l’opposé de cet autre qui ne douterait pas. Être lui, ce serait reposant, mais ce serait aliénant, et faux.
Les poèmes de cette partie suivent le même schéma : se mettre dans les yeux d’un autre, à la place d’un autre, et le sarcasme, qui sourdait dans le premier poème, se fait alors plus manifeste :
« Je voudrais une fois
savoir comment on fait
pour lancer une guerre
contre l’humanité
juste pour exister
dans les livres d’Histoire […] »
Plus la nuit (ombres lunaires)
Dans une deuxième partie, il s’agit de « je », ou plutôt de son effacement, après peut-être s’être perdu(e) à voir à travers les yeux d’un autre.
Si le premier vers peut induire en erreur (« Je marche comme une faucille »), on comprend que ce n’est pas l’auteure qui parle en son nom propre, mais que le « je » est employé à la troisième personne du singulier. Et il en est ainsi dans les poèmes qui suivent (« je ne s’appartient plus », « je n’écrit plus la nuit »), comme pour dire une dépossession, une perte.
A nos pieds (terre de Sienne puis vert)
Le « je » disparu, c’est le « on » qui s’impose, et avec lui revient l’écriture, et ses temps !
« on écrit des poèmes
comme une pyrolyse
pour tout recommencer
sur une plage noire
on écrit comme on vit […] »
Et toujours revient la nature, s’imposent les éléments, immuables, indifférents au temps qui passe et nous efface :
« A la course à la feuille
veillent les liens du temps
les visages de pierre traversent la muraille
et chantent à la rivière
que la joie sauvage
et le blé rugissant
nous survivent »
Horloges à feu (à la chandelle)
Dans ce quatrième chapitre, un mystère s’installe d’emblée : les poèmes sont numérotés, en nombres romains, mais dans un désordre apparent, puisque l’on débute à VIII, pour aller jusqu’à XII puis revenir à I, et deux poèmes portent le même numéro (VIII).
C’est un ensemble dur, de violence, où il est question de « trahir la promesse chaque jour unique », d’un « vieux tronc pourri », de découvrir la mort « dans les bras d’un buisson ». Le champ lexical de la mort revient d’ailleurs plus tard (« ainsi meurent les eaux calmes », « on meurt encore si pâles de n’aimer pas fou »).
L’eau trampoline (ça brille au fond du puits)
Dans ce nouveau chapitre, la fusion de l’humain et de la nature se fait plus marquée encore qu’elle n’était dans les pages précédentes :
« De cette goutte pleine
que fera le brasier
j’ai promis la lumière au jardin
à demain qu’elle vive […]
Dans cette communion, le « je » revient, l’auteure reprend la parole, se réapproprie l’écriture et la contemplation de la nature :
« Naïve
je crois encore
aux fenêtres
aux champignons sincères
aux arrosoirs de cimetière
que personne ne vole
aux jardins de silence (Kommen Sir herrein) […] »
Tout est prêt alors, puisque le je s’est réconcilié avec la nature, pour l’ouverture finale :
Au monde (lumière d’après-midi, l’été)
Cette ouverture se fait dans une sorte de panthéisme :
« Se réparer du monde
un rempart de lichen pour toute religion »
Les poèmes finaux sont brefs : quatre vers au maximum, plus souvent trois, comme si l’essentiel était déjà dit, que tout pouvait à présent être simplement évoqué, comme si, aussi, une légèreté nouvelle se matérialisait à-même la page. Il est temps pour le constat final : « la douceur est », et pour le retour au monde, dans sa plénitude, là où il n’est plus question de guerre et de morts mais de liens, de ponts :
« Passerelle en cordée
tous les ponts disent la même langue
tu n’es pas seule
suspendue aux lèvres du monde »
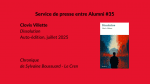
Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés