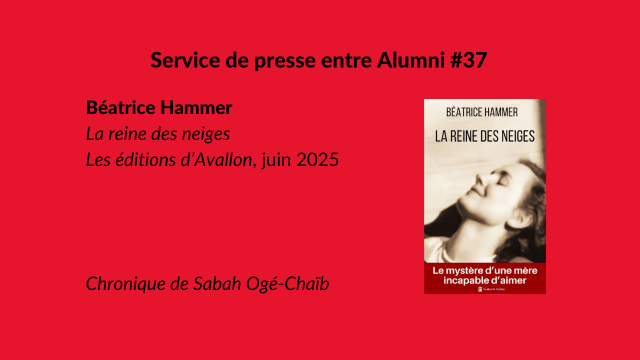Service de presse entre Alumni #37 : La reine des neiges, de Béatrice Hammer
La force d'un roman qui fait de nous des « confidents » ou des « témoins » « face à un événement qui parle à tous : le décès d’une mère » : Sabah Ogé-Chaïb (promo 2010) nous explique pourquoi elle recommande vivement La reine des neiges de Béatrice Hammer (promo 1987), « roman à la construction intelligente et sensible » paru en juin 2025 aux Éditions d'Avallon.
Le livre
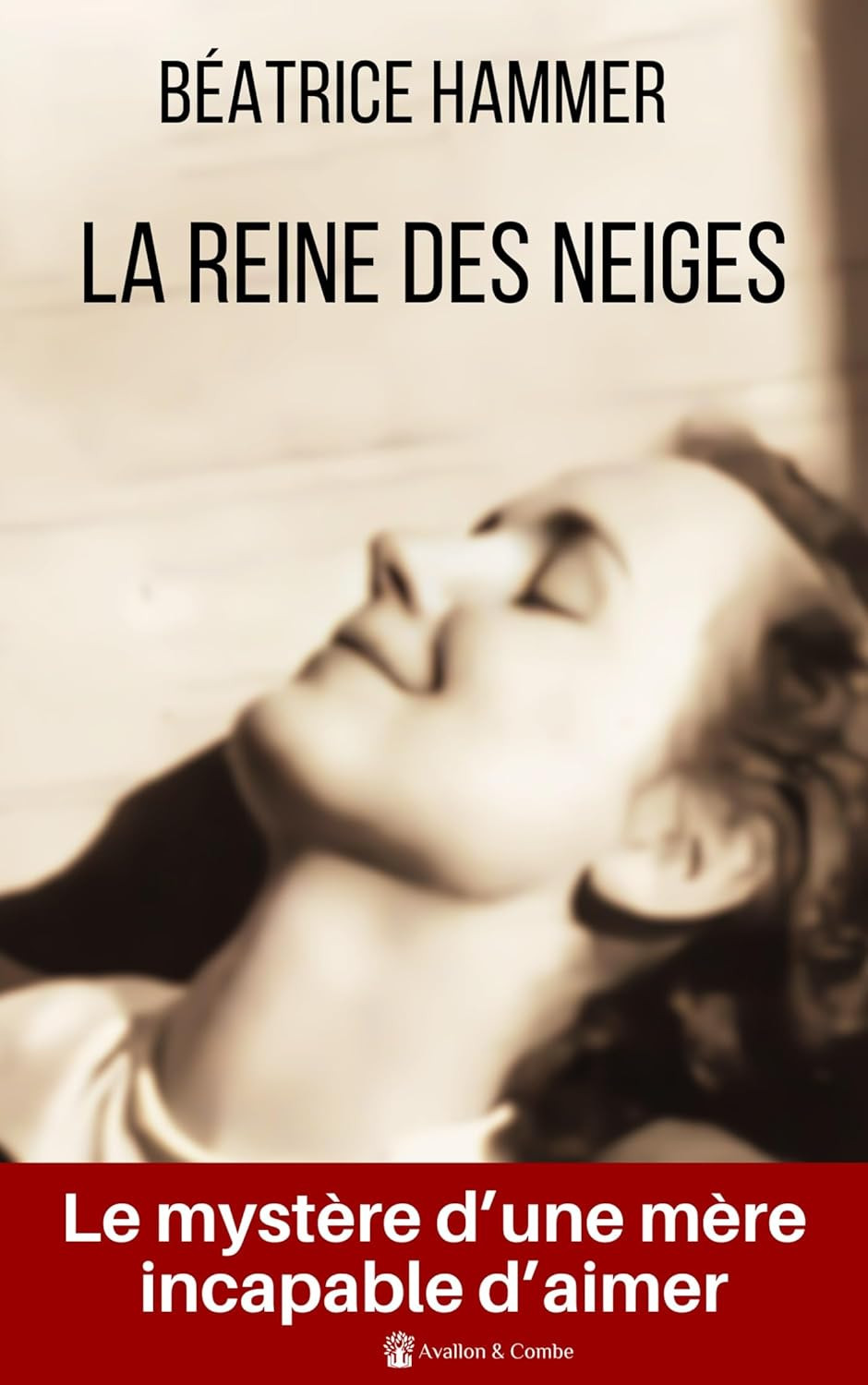
L’autrice
 Béatrice Hammer sur le site Babelio
Béatrice Hammer sur le site Babelio
Béatrice Hammer est une écrivaine française, née à Paris en 1963. Elle est sociologue statisticienne, romancière et cinéaste. Son œuvre littéraire se déploie entre romans, nouvelles, romans jeunesse et théâtre. Son premier roman, Kivousavé (initialement publié sous le titre La princesse japonaise), a été récompensé par le prix Goya en 1995. Elle est l’auteure prolifique d’une vingtaine d’ouvrages chez différents éditeurs et elle a été régulièrement récompensée de prix littéraires (Prix Goya, Prix du premier roman de l'Université d'Artois, Prix du Festival du premier roman de Chambéry, prix Tatoulu, prix Papyrus, prix Livre mon ami etc.). La Reine des Neiges est sa dernière publication parue aux Éditions d'Avallon en 2025.
Présentation du livre par la maison d'édition
À la mort de sa mère, elle n’a rien senti. Ni tristesse, ni joie, ni colère.
Quinze ans plus tard, elle décide de mener l’enquête et de comprendre pourquoi sa mère et elle n’ont jamais pu s’aimer.
Qui était cette femme, au-delà de sa grande beauté ? À quelles fragilités renvoyait sa dureté ?
Son cœur était-il vide et froid comme celui de la Reine des Neiges ?
Un texte d’une sincérité bouleversante.
Trois extraits choisis par Sabah
Ma mère est morte il y a quinze ans.
Je n'ai pas été triste.
Je l'ai appris tôt le matin. Je crois bien qu'il était sept heures, quand le téléphone a sonné ; c'était ma sœur, elle a dit quelque chose d'étrange, maman est partie cette nuit. Elle n'a pas dit maman est morte, mais ça voulait dire ça.
Je l'ai dit à ma fille, la plus petite, c'est elle qui était là. Mamy est morte. Elle s'est mise à pleurer. Son chagrin m'a fait de la peine. Mais moi, je n'ai pas été triste.
Pourtant c'était mon premier deuil. […]
C’est tellement difficile à expliquer. Parce que bien que n’étant pas triste, je suis malgré tout affectée.
Par la certitude de la mort, d’abord : depuis quinze ans, elle ne m’a plus quittée.
Et puis par autre chose : je crois bien que sans le savoir, sans en être consciente, je suis possédée par son ombre. […]
Puisqu’au moins par son ombre, ma mère est toujours là, que je ne peux lui échapper, autant la regarder en face.
Sans m’en apercevoir, j’ai peuplé mes romans de mères abandonnantes, que ce soit de leur propre chef, parce qu’elles fuyaient leur vie, ou bien victimes d’une maladie, d’un accident : d’une façon ou d’une autre, les mères de mes histoires disparaissaient.
Les filles de mes romans se débrouillaient comme elles pouvaient, et elles pouvaient souvent. Elles sublimaient, se révoltaient, imaginaient, niaient, mais l’un dans l’autre, elles s’en sortaient.
L'avis de Sabah
Une grammaire du monde
Dès les premières lignes du roman, le lecteur est fixé sur le sujet au centre du livre : il se trouve d’emblée arrimé à un récit dans lequel la narratrice le considère en confident ou en témoin face à un événement qui parle à tous : le décès d’une mère. Contrairement à ses propres filles ou à son entourage qui ont été affectés par ce décès, la narratrice assume l’absence de tristesse à la mort de sa mère ; elle n’a pas non plus pleuré ; et quinze ans plus tard, elle reste traversée par la même indifférence, en apparence toutefois, car elle ressent toujours sur elle, « l’ombre portée » de sa mère.
La mort de la mère est ainsi le point de départ à un roman autobiographique, puisque le « je » est assumé au regard du « pacte autobiographique » énoncé par Philippe Lejeune. Il faut souligner la force de la scène inaugurale choisie par la romancière qui dans une économie de moyens, nous plonge sans fard, dans sa relation avec sa mère et son univers familial, racontés en 54 petits textes courts d’une page ou deux : les titres de ces petits textes témoignent d’une progression dans le temps et dans le récit.
Le roman adossé au conte d’Andersen La Reine des Neiges témoigne de façon sensible et convaincante combien il faut prendre au sérieux les mythes et les contes car on y lit toute une grammaire du monde, à travers notamment les personnages archétypiques. Le conte d’Andersen qu’elle lit enfant, lui donne les clefs pour une première appréhension et compréhension de sa mère : elle est une Reine des Neiges dans son palais de glace, mère inaccessible, insaisissable et dont « un éclat de miroir avait gelé son cœur » ; l’enfant n’a pas réussi à la libérer de son palais de glace car elle est faite de cette même matière. « Dure et brillante, belle et glaciale, une forme trop pure pour être naturelle, des arêtes tranchantes taillées dans la matière, voilà qui décrit bien la mère que j'ai connue » : la métaphore organique de la pierre de diamant, du charbon ou de la glace, restitue l’image d’une mère en noir et blanc, littéralement une eau-forte.
Ainsi, les premières pages du roman évoquent l’enfance et l’adolescence, et l’impossibilité de capter l’amour et la complicité maternelle. Le cercle familial et amical offre de cruels points de comparaison et donne à l’envi, matière à procès de la figure maternelle : l’enfant ne s’est pas sentie aimée, reconnue, valorisée et les écarts supposés à la norme maternelle (traits physiques et moraux) confortent la petite dernière de l’insurmontable écueil entre sa mère et elle.
Du conte à l’Histoire et vice-et versa
La progression dans le récit et la description par petites touches de la mère, s’accompagnent de la progression du travail sur soi et de l’auto-analyse que réalise la narratrice : « Ma mère était un monstre, en décrétant cela, je lui ressemble trop : ma justice est expéditive, je ne réfléchis pas et condamne sans appel. (…)
Ma mère n’a pas été qu’un monstre.
Elle n’était pas seulement dysfonctionnelle, pas seulement négligente, pas seulement maltraitante ».
Avec le texte intitulé précisément « Nuances », s’opère progressivement le décentrement du regard : l’attention égocentrée sur la relation fille-mère se déplace sur une focale plus large, celle de l’histoire familiale de la mère. Ce faisant, le regard gagne en profondeur, lesté du poids du passé et du désir de documenter tel un enquêteur, la vie de la mère, à même de donner corps et chair à un personnage alors désincarné.
« Remonter » l’histoire d’une famille polonaise émigrée en France dans l’entre-deux guerres, dans ses heurts et malheurs, c’est remonter aux sources du « culte du malheur » à travers lequel la mère appréhende le monde et à la clé de compréhension de son souci des apparences et de la perfection : accueillie une dizaine d’années chez une vieille demoiselle, elle accédait à une condition sociale supérieure à sa condition d’immigrée, en donnant sans cesse des gages pour mériter l’hospitalité de cette maison bourgeoise. Cette perfection érigée en protection, porte en elle sa part d’arrachement à sa famille d’origine, de solitude et de peine rentrées, de dévouement et de loyauté obligée et bafouée : à la mort de la vieille demoiselle, elle se retrouve littéralement à la rue. « L’origine des apparences », « L’étrangère », « Le mariage pour ne pas sombrer », sont des textes qui révèlent précisément la dimension tragique de l’histoire maternelle.
Le décentrement du regard n’a pas opéré un retournement total du regard de la narratrice dans sa relation avec sa mère. Le personnage du conte s’est néanmoins complexifié d’une humaine fragilité (« La fin de la beauté », « Ma mère vieille enfermée », « Les mêmes mélodies », « La peur » ).
Et la narratrice de conclure : « Ici j’ai partagé mon héritage. Je me suis certainement trompée en poursuivant ma vérité. J’ai creusé comme j’ai pu dans ma réalité. J’ai tourné, retourné le pot, versé des larmes et tenté d’arracher cet éclat de miroir hors du cœur de ma mère.
Un éclat de miroir qui n’a sans doute pas existé, même s’il m’a éclairée sur le chemin. La Reine des Neiges a-t-elle un cœur ? Andersen ne le précise pas ».
La littérature pour voie d’apaisement
Dans une histoire de transmission problématique entre une mère et sa fille, il y a quelque chose qui peut être sauvé : « Avant de m’arrêter, il faut que je raconte une dernière chose. [...]
[...] tout au fond du palais de glace, il y avait une bibliothèque ». La narratrice reconnait l’amour des livres que sa mère lui a communiquée et ce lien précieux qui les relie, est à même de donner enfin crédit à la figure maternelle : « Une personne qui adore les livres ne peut être tout à fait mauvaise ».
Le succès du premier roman de l’auteure-narratrice, La princesse japonaise (1995 ; réédité sous le titre Kivousavé), offre à la mère de pouvoir être fière chez la coiffeuse, et à la fille « de toucher le Graal ». C’est encore à ce livre apprécié par la mère - « un moment de grâce » pour la narratrice -, de délivrer une parole salvatrice à propos d’un personnage du roman et inspiré en réalité d’elle-même : « Cette Vieille, tu la détestes, elle ne te comprend pas, tu penses qu'elle t'en veut, elle te détruit et elle te fait du mal. Je te comprends. Tu as raison. [...] pourtant cette Vieille, un jour, il faudra que tu lui pardonnes ». Par cette recommandation pour un pardon salutaire, la mère remplit pleinement aux yeux de sa fille, son rôle de mère, en lui montrant la voie de l’apaisement et de la libération.
Pourquoi ce livre devrait plaire aux Alumni
Le goût qui porte le lecteur vers un genre plutôt qu’un autre, ici un roman autobiographique, peut intriguer, particulièrement pour ce genre littéraire dont la lecture résonne nécessairement de façon singulière chez chaque lecteur. La construction intelligente et sensible du roman de Béatrice Hammer, la justesse du propos méritent de s’y attarder ; mieux de s’y attacher. Souhaitons-lui un succès de librairie comme l’ont connu d’autres ouvrages sur le même propos (Rien ne s’oppose à la nuit de Delphine de Vigan ; Les fillettes de Clarisse Gorokhoff ; Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin ; Frappe-toi le cœur d’Amélie Nothomb ; Les dévorantes de Marinca Villanova, etc.).
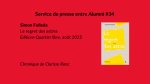
Comments0
Please log in to see or add a comment
Suggested Articles